QH88 là nhà cái quốc tế, chính thức ra mắt thị trường vào năm 2012 và có trụ sở được đặt tại Philippines. Với giấy phép hoạt động được cấp bởi Cục quản lý giải trí và trò chơi Philippine, nhà cái đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh, cá cược tại đây đều đảm bảo uy tín và được giám sát thường xuyên. Hãy đăng ký tài khoản Qh88 để nhận ngay 100k trải nghiệm cổng game hoàn toàn miễn phí.
QH88 – Nhà Cái Đứng Top Đầu Châu Á 12 Năm Liên Tục
Với sự phát triển mạnh mẽ của loại hình cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, ngày càng có nhiều trang web tự xưng là nhà cái để thu hút người chơi. Tuy nhiên, cái tên Qh88 luôn giữ vững một vị trí quan trọng trong cộng đồng bet thủ. Trở thành nhà cái thu hút được nhiều người chơi nhất hiện nay tại Việt Nam. Với giấy tờ pháp lý đầy đủ, đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng sản phẩm, tung ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn nên đã tạo được dấu ấn cho trong lòng người chơi.

Với sự thành công của mình đã đạt được, nhà phát triển tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là sự cam kết vào hệ thống an toàn, bảo mật cho mọi khách hàng khi đến đây. Sự uy tín và minh bạch của QH88 được chứng minh qua:
- Thành lập: 16/08/2012
- Trụ sở: Manila – Philippines
- Giấy phép hoạt động: Cục quản lý giải trí và trò chơi Philippines – PAGCOR. Cùng với đó thì mọi sản phẩm cá cược tại đây được quản lý và giám sát bởi Công ty Cổ phần Giải trí & Nghỉ dưỡng First Cagayan.
- Giấy phép kiểm duyệt game: Nhà cái nhận được 5 giấy chứng nhận game của BMM Testlabs. Đây là kiểm định nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong mọi hoạt động cá cược của trang game.
- Giải thưởng: Nhà cái uy tín số 1 châu Á vào năm 2015, 2016, 2017, 2023. Cùng với nhiều giải thưởng do Asian awards cung trao tặng.
- Là nhà cái luôn đứng top dầu trên các diễn đàn về nhà cái uy tín.
Qua những thông tin trên đây, có thể thấy nhà cái đã khẳng định sự uy tín và chuyên nghiệp của mình. Nhà phát triển luôn đặt lợi ích của người chơi lên hàng đầu, hoạt động với phương châm lấy chữ tín làm nền tảng của sự phát triển. Luôn nỗ lực để mang lại lợi ích cho người chơi. Chính vì vậy mà đã giúp cho Qh88 trở thành nhà cái được yêu thích nhất, là địa chỉ cá cược quen thuộc của đông đảo bet thủ và trở thành Nhà Cái Uy Tín số 1 hiện nay.
QH88 Có Gì?
Với mục tiêu duy trì và phát triển vị trí số 1 tại thị trường cờ bạc châu Á, nhà phát triển luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng, cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Và để giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều thú vụ của nhà cái này, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đánh giá những trải nghiệm của sân chơi này ngay sau đây:
3 Sản phẩm nổi bật nhất của QH88
Kho game tại nhà cái Qh88 luôn được khách hàng đánh giá cao nhờ vào chất lượng, sự đa dạng và chuyên nghiệp. Và hiện tại, trang game đang có 3 sản phẩm mũi nhọn, được nhà cái đầu tư kỹ lưỡng và cũng được khách hàng đánh giá cao.
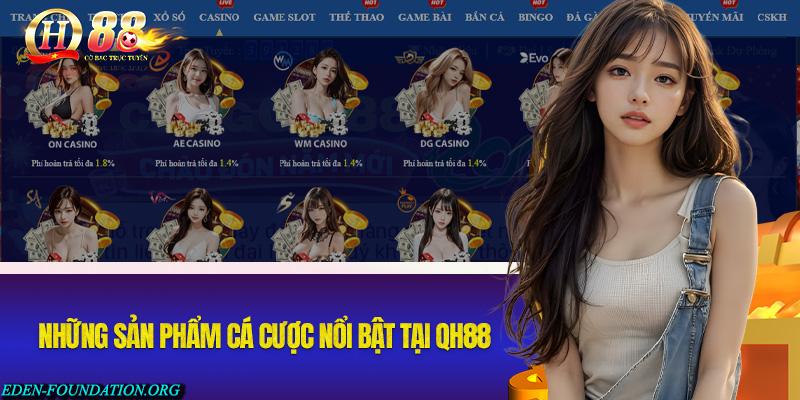
- Cá cược thể thao: Bet thủ có thể tham gia cá cược vào hàng trăm bộ môn thể thao khác nhau, từ bóng đá, bóng rổ, thể thao điện tử. Cung cấp hàng nghìn sự kiện thể thao mỗi tuần và nhiều loại kèo cược hấp dẫn cho người chơi thỏa sức trải nghiệm như kèo tài xỉu, kèo châu Á, kèo châu Âu, cược nửa trận, cả trận…
- Casino Live: Bạn có thể tham gia vào rất nhiều trò chơi casino hấp dẫn, có thể kể đến Baccarat, Blackjack, Tài Xỉu, Rồng Hổ… Các bàn chơi đều được phục vụ bởi dealer xinh đẹp, với nhiều mức cược khác nhau cho anh em lựa chọn.
- Một số game phổ biến khác: Ngoài ra còn một số trò chơi cá cược phổ biến khác như nổ hũ, bắn cá, game bài, xổ số, đá gà….
5 Dịch vụ nổi bật của nhà cái Qh88
Với sự phát triển của thị trường cá cược, cùng với tiêu chuẩn, nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhà phát triển đã luôn nỗ lực để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Cụ thể:

- Hỗ trợ trực tuyến Qh88: Một đội ngũ CSKH chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng và luôn nỗ lực hết mình phục vụ khách hàng đã được nhà phát triển đào tạo và tuyển chọn kỹ lưỡng. Người chơi có thể nhận được giải đáp bất cứ lúc nào thông qua đa dạng kênh hỗ trợ như: Chat trực tuyến, Telegram (+84788703125), Email ([email protected]), Hotline (+84328327888), zalo (+84562673021)
- Ứng dụng: Người chơi có thể trải nghiệm chơi game, giao dịch trên cả PC hay ứng dụng. Nhà cái hỗ trợ khách hàng tải app cho cả hệ điều hành Android và iOS. Đặc biệt thì ứng dụng được thiết kế, tích hợp để cung cấp đầy đủ trò chơi, tính năng tương tự như trên website.
- Khuyến mãi: Đăng ký tài khoản nhận ngay 100k trải nghiệm cổng game, tặng ngay 100% giá trị tiền nạp trong lần đầu tiên cùng hàng ngàn khuyến mãi khác đang chờ đợi người chơi.
- Giao diện Mobile: Không chỉ nổi bật với giao diện website, mà với giao diện ứng dụng được tạo ấn tượng với hội viên. Với màu sắc hài hòa, các thông tin chính được thể hiện rõ nét. Các phím chức năng được bố trí một cách thông minh và khoa học. Chính vì vậy mà dù bạn là người mới đăng ký tài khoản tại đây cũng có thể dễ dàng thao tác.
- Bảo mật thông tin tuyệt đối: Mọi thông tin và giao dịch của khách hàng đều được xử lý, mã hóa bằng hệ thống an toàn, công nghệ bảo mật SSL 128 bit. Để từ đó ngăn chặn hành vi đánh cắp, lộ lọt thông tin khách hàng. Đồng thời chúng tôi cũng cam kết không để lộ, bán, trao đổi thông tin của khách hàng tới bất cứ bên thứ 3 nào, kể cả là chính phủ.
Lời Kết
Sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, cho đến hiện nay, nhà cái QH88 đã khẳng định được vị thế vững chắc, có được chỗ đứng trên thị trường cá cược trực tuyến. Với hệ thống trò chơi đa dạng, chất lượng, bảo mật thông tin tuyệt đối, đa dạng khuyến mãi, hỗ trợ nhanh chóng… Nhà cái QH88 chắc chắn là địa chỉ không thể bỏ qua đối với các bet thủ.
